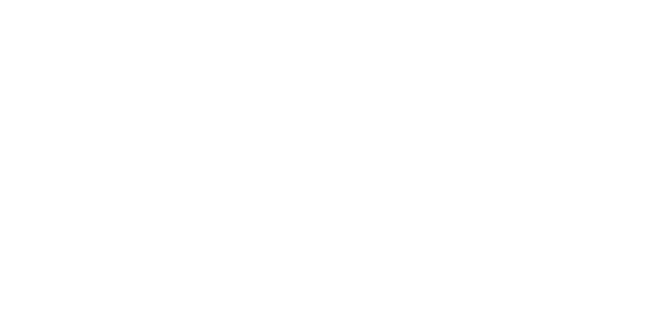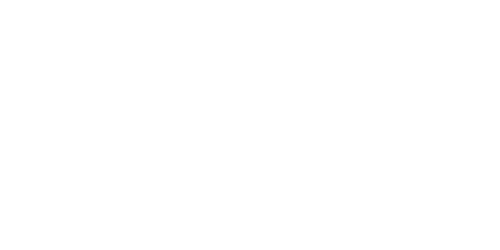Si la grève était une discipline olympique, le Québec monterait invariablement sur la plus haute marche du podium national. Les données d'Emploi et Développement social Canada sont, année après année, stupéfiantes : alors que le Québec représente environ 23 % de la population canadienne, il cumule régulièrement plus de la moitié, voire les trois quarts, des jours de travail perdus pour cause d'arrêts de travail au pays.
L'année 2023, marquée par la mobilisation historique du Front commun et de la FAE, a exacerbé cette tendance, mais elle ne l'a pas créée. Cette propension à débrayer distingue le Québec de ses voisins anglo-saxons. Est-ce le signe d'une société dysfonctionnelle ou la preuve d'une vitalité démocratique ?
Une question de densité... syndicale
Pour expliquer ce phénomène, il faut d'abord regarder la démographie des organisations. Le Québec est, de loin, la province la plus syndiquée au Canada. Avec un taux de syndicalisation approchant les 40 % (contre moins de 30 % en Ontario et à peine plus de 20 % en Alberta), la probabilité mathématique d'un conflit de travail y est naturellement plus élevée.
Mais au-delà des chiffres, c'est la nature du syndicalisme québécois qui diffère. Ailleurs au Canada, le syndicalisme est souvent perçu sous un angle strictement contractuel (Business Unionism). Au Québec, héritage de la Révolution tranquille, le syndicalisme est « social » et politique. Il se veut un contre-pouvoir. La rue est considérée comme une extension légitime de la table de négociation, une culture de la contestation qui est beaucoup moins ancrée à Toronto ou à Calgary.
Le choc de l'inflation et du service public
La vague récente de grèves s'explique aussi par la structure de l'économie québécoise. L'État québécois est un employeur omniprésent. Lorsque le gouvernement négocie, il ne négocie pas avec une seule usine, mais avec un demi-million de personnes d'un coup. Un échec à la table centrale paralyse donc instantanément la province entière (écoles, hôpitaux).
De plus, les dernières années ont marqué un point de rupture. Comme le soulignent les économistes, la résurgence de l'inflation a percuté de plein fouet des conventions collectives signées à une époque de stabilité des prix. Le « rattrapage » salarial est devenu le mot d'ordre. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, le rapport de force s'est inversé : les travailleurs, conscients de leur valeur marchande et épuisés par les conditions de travail post-pandémie, n'hésitent plus à utiliser l'arme atomique de la grève générale illimitée.
Un mal nécessaire ?
Il est facile de s'exaspérer devant les écoles fermées et les services ralentis. L'impact économique à court terme est indéniable. Pourtant, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de lier cette combativité syndicale aux avantages sociaux dont jouissent les Québécois.
Si les inégalités de revenus sont plus faibles au Québec qu'ailleurs en Amérique du Nord, c'est en partie grâce à cette pression constante exercée par les syndicats sur les salaires et les conditions de travail, pression qui finit par avoir un effet d'entraînement sur le secteur privé.
Conclusion
Le nombre élevé de grèves au Québec est le symptôme bruyant, et parfois pénible, d'un choix de société. Nous avons choisi un modèle où la richesse est davantage redistribuée et où les services publics sont centraux. Le revers de cette médaille, c'est que la négociation de ce contrat social se fait parfois dans la douleur et le tumulte.
Le Québec ne cessera pas de faire la grève de sitôt. C'est dans son ADN politique. Le défi, pour le gouvernement comme pour les syndicats, est de s'assurer que cette « culture du conflit » débouche sur de réelles améliorations des services aux citoyens, et non sur une guerre d'usure perpétuelle où l'usager est le seul véritable perdant.
Soyez prêt à l'imprévisible